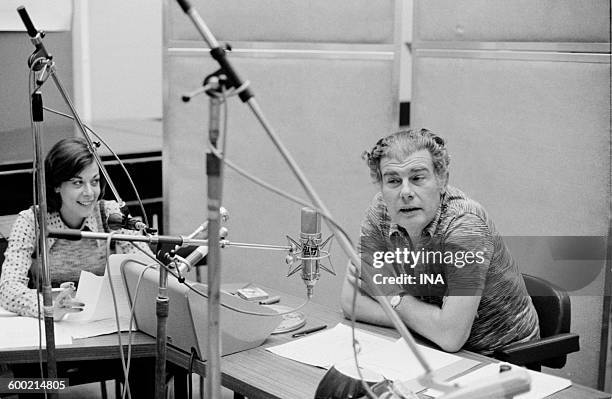D'abord… D'abord, il y a cet indicatif envoûtant… Aussi envoûtante la voix d'Alain Veinstein "Surpris par………… la nuit". Et le plaisir de découvrir un programme enveloppé du silence de la nuit. Les yeux fermés, l'ouïe en alerte et le sourire au coin de l'oreille. Cette nuit (il est 4h26), Philippe Garbit nous annonce "Une véritable enquête". Sur le Nox, le Berry, le Berry-Zèbre et le Zèbre. Un seul et même établissement niché à Belleville. Ce quartier parisien qui va se transformer sous nos yeux des années 50 au milieu des années quatre-vingt dix. Et c'est une véritable enquête que vont mener, pour France Culture, Christine Delorme, productrice et Anna Szmuc, réalisatrice.
 |
| Devanture du Zèbre |
Aux Archives nationales, Christine Delorme égraine des nombres, 61,62, 63. Au 63, se tient le cinéma de quartier Le Nox, Boulevard de Belleville, dans le XIè arrondissement de Paris. Christiane Leproux, ancienne gérante du Berry, sera le fil rouge de ce documentaire. Avec une verve et une sincérité touchante. Devenu le Berry, le cinéma deviendra un cirque, plutôt que toutes les affreuses choses auxquelles il a échappé. Garage, supermarché, fast-food. C'est sûr on vient de pénétrer dans la troisième d'une autre époque. L'attachement d'un quartier pour son cinéma qui lui crée son identité propre. Sa clientèle fidèle comme celle de passage. Sa patronne, Christiane Leproux, figure locale en prise avec la population attentive et intuitive pour faire coller sa programmation aux choix de ses publics.
Delorme et Szmuc, vont dérouler méthodiquement l'écheveau de cette histoire sensible autour d'un lieu fédérateur, d'un lieu social en prise avec son quartier et en dehors des clous de ces lieux qui vendent des pop-corns et autres sodas glacés. À partir de 1984, la salle mute en "Théâtre et cinéma" pour tenter de concilier la baisse de fréquentation cinématographique par la diffusion de spectacles vivants. Et Suzanne-aux-yeux-bleus (Christiane Leproux) comme l'appelle Daniel Pennac, avec sa verve féconde ne se lasse pas de refaire le film de l'épopée Bellevilloise de son cinéma-théâtre-cirque. Par exemple en 1951, quand ils ont acheté le cinéma il y avait onze salles à Belleville. Le cinéma était le divertissement populaire par excellence.
Parmi les clients, Frédéric Mitterrand, Claude Lelouch, Enrico Macias,… Le Berry était le seul cinéma qui passait des films pour enfants. C'est comme ça que Nathalie Baye est venue voir la guerre des boutons avec sa fille. Et des enfants venaient même de banlieue en car ! D'autres belles histoires évoquent ce lieu avec Jacques Higelin par exemple… Où l'on mesure l'importance d'une histoire tissée de milles histoires qui donnent une âme, une empreinte, un parfum à une adresse qui bien plus qu'un numéro deviennent un point d'ancrage dans la ville. Un repère affectif. Un coin où il fait bon exister.
Daniel Pennac dénoncera la destruction du lieu. Le propriétaire des murs veut vendre. Le zèbre indomptable est muré en 1994. Squatté, défendu par des associations, le lieu continue d'exister en connaissant de multiples péripéties. Il sera finalement racheté en 1999 et transformé en cabaret-cirque par un ancien clown, Francis Schoeller. Le Zèbre de Belleville rouvre ses portes en 2003.
Vous le savez, il y a les bons documentaires, celui-là est très bon. Fouillé, documenté et très bien raconté. Christine Delorme est décédée le 26 février 2020 à Paris après avoir produit de nombreux documentaires pour France Culture.
Un documentaire du 17 juin 2003.