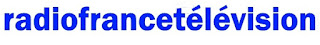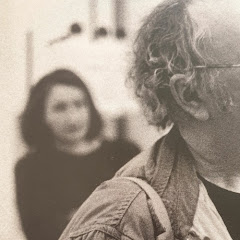J'ai terminé la lecture il y a quelques jours de "Bob Dylan électrique" (1). Un immense plaisir à lire un travail scrupuleux autour d'un mythique festival folk aux États-Unis de 1958 à 1969. La fracture folk/rock de 1965 m'a évoqué celle qui nous bouscule au niveau de la radio publique. Les anciens, incapables de se réjouir de l'avènement du podcast et de la diminution drastique du temps d'antenne consacré à des programmes frais. Les modernes, passionnés par un accès permanent à des émissions détemporalisées (2). Les anciens Pdg de Radio France (1975-2014) s'attachant à faire vivre la radio publique au quotidien, les nouveaux (2014-2025), manageurs de la mutation de la radio en audio.
 |
| Maison de la radio publique, Paris |
Dans cette affaire, bien sûr, j'ai choisi mon camp ou, plutôt, il est si facile pour mes détracteurs de me ranger dans la case "has been, nostalgique, rétrograde,…" et plus si "désaffinités" ! Sauf que, biberonné pendant 60 ans (4) à la radio, à des programmes d'"hiver", à des programmes d'été, à des voix régulières à l'antenne, j'avale assez mal la couleuvre de la mutation à marche forcée d'une riche histoire humaine autour de la création radiophonique, de sa fabrique quotidienne par les différents métiers utiles à sa diffusion, de la casse du processus de production. Tout ça absolument motivé par les injonctions de la Cour des Comptes et du Ministère de l'Économie dans le but de réduire drastiquement la masse salariale et, ce faisant, casser l'indispensable existence d'un service public de l'audiovisuel.
Un exemple, l'intuition et la volonté de Laurence Bloch quand, Directrice de France Inter (2014-2023) elle fait basculer de l'antenne Philippe Collin et lui offre un boulevard de création de podcasts autour de l'histoire. Avec en prime un staff opérationnel de six à huit personnes. Bloch et Collin pouvant se targuer d'écoutes par millions (30 cumulées au mois de janvier). Tant pis pour le temps consacré à l'histoire à l'antenne, tant pis pour Jean Lebrun (disparu de la grille), tant pis pour les quelques minutes de Stéphanie Duncan (1 heure le dimanche à 21h), tant pis même pour l'histoire autre que celle des vedettes (médiatiques et mainstream) choisies par Collin.
Au titre de la souplesse (accès permanent aux sons), de l'individualisation des podcasts les uns par rapport aux autres, de la sur-médiatisation des vedettes du micro, de l'abandon de l'œuvre collective d'une antenne, de sa couleur, de ses animatrices et animateurs, de sa continuité temporelle, "on" a muté définitivement la radio comme identité médiatique et comme mémoire globale en une infinité de "petits bouts", isolés les uns des autres comme autant de produits à promouvoir, comme des paquets de lessive ou des barres de céréales. Tout ça réuni dans un grand-magasin (une plateforme) Radio France où, petit à petit, les chaînes y perdront jusqu'à leur dénomination.
Comment ne pas aimer Dylan électrique quand, dès 1978, Bernard Lenoir nous en faisait quelques "Feedback" bien sentis. Comment ne pas aimer Dylan folksinger quand sur France Inter, Claude Villers, Patrice Blanc-Francard, François Jouffa, Maurice Achard, Pierre Lattès et aujourd'hui Michka Assayas nous donnaient à chanter avec lui (sans forcément le suppléer à l'harmonica). La radio devrait s'attacher à perpétuer ses programmes et à les enrichir sans que cela ne l'empêche d'ouvrir les rediffusions permanentes via le podcast. C'est un choix de société à faire. Gallet et Veil (Pdg et Pdgère depuis 2014) ont fait le choix facile des renoncements. Renvoyant aux marges les vieilles barbes, les scrogneugneu, les pisse-vinaigres et autres déçus de l'évolution d'un progrès "cache-misère". Sacralisant ces nouveaux adeptes numériques en leur permettant sur tous les supports l'accès au Graal et plus si affinités !
"Ils nous prennent pour des audios", nous l'avions déjà écrit avec David Christoffel. Pour des audios alors que, plus que jamais, nous sommes des radios-amateurs. Amateurs de cette radio-là, collective et singulière, créative et chercheuse, partenaire et complice de nos jours et de nos nuits.
Ajout du 3 mars, 11h
"« La TV permet de découvrir des podcasteurs dans un contexte différent. Elle est la nouvelle radio de la maison, commente Steve McLendon [YouTube]. Beaucoup de gens allument la TV pendant qu’ils préparent à manger, et c’est souvent comme ça qu’ils se mettent à écouter des podcasts. » (Le Figaro, 1er mars 2025). Voilà qui donne des perspectives extraordinaires pour le rapprochement (holding ?, fusion ?) Radio France/France TV. Si ce n'était pas assez clair pour annoncer "Radio killed the video star"…
(1) Bob Dylan électrique. Newport 1965. Du folk au rock. Histoire d'un coup d'État. Elijah Wad. Rivage Rouge, 2017,
(2) Le mot "émission" n'existe plus dans la nov langue de Radio France. Tous les programmes "proviennent du podcast"… Un signe assez fort pour faire entrer la mue au chausse-pied et stigmatiser les "croulants" (3) qui bégayent encore le mot "émission",
(3) Dans les années 60, sur Europe n°1 dans l'émission "Salut les copains" animée par Daniel Filipacchi, on distinguait déjà ces vieux (de plus de 20 ans) incapables d'être dans le vent des yé-yé,
Ce billet a été rédigé sans avoir recours à l'I.A.